

CHARLIE’S ANGELS : LES ANGES SE DECHAÎNENT
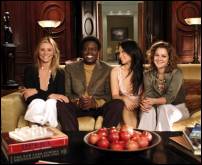
En effet, elles doivent retrouver deux étranges anneaux en titane sur lesquels a été encodée l’intégralité du programme national de protection des témoins. Et ce, bien entendu, avant qu’ils ne tombent entre les mains des organisations criminelles de tout bord. Rien d’insurmontable si ce n’est que le nom de Dylan figure sur cette liste et que l’ancien amant qu’elle a fait incarcéré ne semble pas particulièrement enclin au pardon. Comme un malheur n’arrive jamais seul, il se pourrait qu’une ancienne «ange», Madison Lee, ait initié ces exactions sous l’impulsion d’une ire vengeresse et jalouse.
Dissolution. Un ange apparaît et en pousse un autre vers la sortie : tout l’enjeu d’un film en vase clos incapable de s’ébattre sous le poids écrasant de la référence. Car ce qui frappe en premier lieu dans ce cocktail délirant, iconoclaste et déjanté, c’est sa structure centripète. Il est balayé par les spasmes stroboscopiques d’un vortex de clins d’œil, de pastiches à l’ironie irisée et de déhanchements cadencés ou hystériques. Le problème de ce patchwork erratique et endiablé demeure que malgré toutes les astuces de caméra, la virtuosité des combats et la maîtrise ahurissante du clippeur invétéré McG pour tout ce qui est des effets tendance et funky, il ne semble jamais en mesure de prendre son essor, d’esquisser le moindre mouvement. Il reste enraciné sur l’œil du tourbillon. De cet assemblage fait d’idiosyncrasie – un scénario vaste prétexte à toutes les folies et positions émoustillantes – et de glamour vulgaire – un séquence de calembours à consonance anale pour heurter tout bon quaker – se dégage une logique tubulaire, enserrée autour d’un famélique et asthmatique squelette. Rien de trépidant ou de saisissant donc dans un brouet un tantinet éventé. Les références et les caméos sont légions : Bruce Willis fait une visite pour passer de vie à trépas, les jumelles Olsen ont un plan fugitif, Matt Leblanc charrie les fonds de tiroir de Friends et citons pêle-mêle les Monty Pyhton, C.S.I. – dans une parodie hilarante et soignée jusqu’au moindre détail –, Magnum P.I., Flashdance, MI-2, Starsky & Hutch, James Bond, Terminator 2, le transformisme grotesque et toc de Moulin Rouge... Le film se transmue au fil des minutes en une progéniture putative de toute la pop culture américaine des trente dernière années jusqu’à singer dans un segment comique le style scatologique et burlesque d’un Mary A Tout Prix. Mais contrairement à la série télévisée Fastlane dont il est l’un des instigateurs, le cinéaste ne parvient pas ici à déconstruire les pastiches et la glose sur lesquels il bâtit son récit pour l’ensemencer de scories nourricières. Autant dire qu’il peine à assurer voire assumer une quelconque émergence ou façonnage d’identité. En aucun cas les starlettes en petite tenue, modèles pour une garde-robe fashion ou gamines dissipées, n’auront accès à un univers propre les mettant en danger. Ici on préfère la mécanique cacophonique, pachydermique et parfaitement huilée à l’ambiguïté fertile. Jusqu’à offrir un divertissement lyophilisé et anorexique où histoire et protagonistes – le combat Dylan/Madison avec ses corps digitaux prenant un dimension cartoonesque – se dissolvent dans le brouhaha ambiant, lymphatique et outrancier. Seuls quelques grumeaux dans la surenchère sont synonymes d’une vie propre affleurant en catimini. Syncrétisme anémique et foutraque, ce Charlie’s Angels «à plein gaz», pour paraphraser le titre anglo-saxon, procède d’une confrontation entre les pouvoirs de mythification de la télévision et du cinéma. Le premier média, parangon de l’empathie, gonfle artificiellement les personnages d’un vécu et d’une connivence, leur permettant de se développer dans un continuum spatiotemporel oblong. Avec le Septième Art, les corps sont asséchés, étirés, inertes sans leur dynamique échevelée type ping-pong et annihilés par la taille de l’écran géant.
 |
L’autorité tutélaire. Le gynécée hilare aux prises avec des circonvolutions ostentatoires a tout d’un groupe d’adolescentes arrogantes, indisciplinées et écervelées qui n’hésite pas à railler tout ce qui les entoure et encore plus les épiphénomènes qu’elles déclenchent. Nous assistons ainsi dans un tropisme effervescent et enchanté aux pérégrinations dissipées de trois turbulentes surdouées qui, lunaires, n’incarnent leurs personnages que par intermittence. Comme si elles octroyaient en dernier recours leurs reflets graciles au spectateur-écran dernier invité à la fête débridée et désinvolte. De cet état de fait naît, à la vision du long métrage, une étourdissante hypnose entre nausée violente et enchantement orgasmique. Quel meilleur paradigme de la décomposition de l’identité et de ses frontières floues et fluctuantes ? A l’acmé d’un nouvel idiome visuel |
| vertigineux et amaurotique, concocté à force de scratch et battements sourds de la bande son, survient l’enjeu principal, à savoir le leitmotiv psychanalytique : «tuer le père». Dépossédées de leur mentor de substitution – Bill Murray ayant décliné cette suite pour se perdre chez Sofia Coppola, il est remplacé par un autre protagoniste campé par Bernie Mac qui tente laborieusement de retranscrire la verve comique désopilante qu’il dispense sur petit écran –, les anges doivent se résoudre à reconsidérer leur noyau familial et à rechercher une nouvelle figure à laquelle se raccrocher et s’opposer. Mais le facétieux Charlie leur refuse son image, jusqu’à la folie pour Madison. Elles en sont réduites à habiter une scène rejouant les mêmes airs ou les mêmes clichés et à jongler inexorablement dessus. La fatalité de la musique environnante : elle emplit l’air, autant danser. Les visages se fardent, se modèlent à l’envi – Cameron Diaz et sa prothèse –, comme pour s’infiltrer dans les sombres interstices de la fiction, accéder à la frontière de la personnalité tridimensionnelle. Les références régurgitées par le film ne sont finalement jamais exploitées si ce n’est qu’au comble de la paraphilie un processus de déni de cette stérilité s’engage – Dylan renierait-elle sont androgynie ? – comme pour recouvrer une identité après l’avoir ensevelie sous les délires de pacotille. Atteindre l’autonomie des êtres – qui créeront leur propre musique – et non de l’ensemble – ces surnoms ou abréviations de prénoms en disent long sur l’agrégat des trois jeunes femmes. Abattre les digues et permettre la fuite en avant des flux (sanguins ou autres). Le rideau nostalgique transpercé, l’oeuvre se drape d’oripeaux féministes et dégagés dans la relation dégénérée d’avec le directeur de l’agence qui converse via un haut-parleur (voix de John Forsythe) – d’où la filiation impossible. Harassées d’obéir aux ordres de ce fantoche ectoplasmique – paradoxe du Girl Power –, elles se réapproprient le contrôle de leurs vies. A ce titre, la sculpturale et féline Demi Moore, au sourire vénéneux et satisfait, devient la raison d’être du microcosme, une héroïne à la sexualité triomphante et agressive se retrouvant pourvue de deux gigantesques pistolets dorés un rien phalliques. Ses yeux verts étincelants, ses muscles longilignes et sa silhouette de prédateur amaigri en disent long sur sa détermination sardonique, «pourquoi être un ange quand on peut être Dieu» nous assènera-t-elle. Autant comprendre : pourquoi accepter de ne pas avoir de sexe – et donc de ne pas s’en servir comme arme – lorsque l’on peut fusionner et tirer profit des deux. Pari gagné tant l’actrice s’épanouit et aguiche dans la fièvre et la nonchalance d’une jouissance sybarite et rythmée. Il faut dire que la carence de regard paternel a eu pour résultat la recherche névrotique de la focalisation des autres iris sur sa personne. Tandis que les anges préfèrent, de leur côté, entretenir l’illusion par une attitude «papy gâteau». Elles tolèrent les excentricités de leur gentil mécène en lui accordant un semblant d’autorité. Outre le milliardaire invisible, ce sont les hommes et les spectateurs qu’elles bernent sur une quelconque possession ou tout pouvoir qu’ils pourraient exercer sur leurs personnes rebelles et audacieuses. En un sens cependant ce sont elles-mêmes qu’elles leurrent.
|
|
F.
Flament |
Film américain de McG (2003). Au milieu du déluge outrancier de déhanchements glamour et de délires iconoclastes pointe le constat désenchanté d'une castration et d'une aliénation par des références suffocantes. Sortie française : le 16 Juillet 2003.

Multimédias
Bande-annonce
/ Trailer
Photographies
(54)


 |