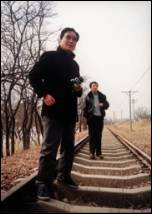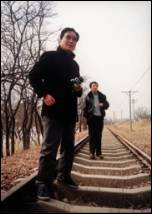|
prompte
à houspiller ses ouailles et à leur rappeler leur incurie
mais réticente à expliquer comment son beau-frère
a pu acquérir de nombreuses terres de la commune pour un prix
dérisoire. Il est loin le temps de la félicité,
où le village était honoré comme la collectivité
(presque un sovkhoze) modèle de l'année 1999, mais pas
si éloigné le temps du Grand Bond En Avant, où
la révolution culturelle foulait au pied la diversité
d'opinion et étiquetait tout individu demandant des comptes
au comité comme membre subversif devant être rapidement
"rééduqué" et évacué
de l'horizon. On ne disparaît plus du paysage pour avoir élevé
sa voix mais au prix de jacqueries incongrues et iconoclastes (pratiquement
mafieuses) on peut se retrouver comme ce pauvre hère malmené
et raillé par les hommes de M. Lu. Tout le reste du film est
à l'avenant, véritable guerre de tranchée entre
des conjurés et un monarque en fin de règne, pathétique
femme qui ne parvient jamais à conserver la dignité
hiératique dont elle aime à se draper. C'est que M.
Lu a eu l'intelligence d'organiser sa coalition d'opposition autour
d'un homme parfaitement intègre, un simple comptable emprunté,
entouré d'une aura virginale et altruiste, M. Tan, le parfait
camarade manipulable et indolent. Il est amusant de voir avec quelle
décence et gêne il assiste au scrutin, s'écarte
stoïquement des tumultes et de l'ire vengeresse de son adversaire,
blessée dans son orgueil. Tout au long du récit, Jinchuan
Duan (auteur des documentaires remarqués The Square
et N°16 Barkhor Street South) parsème des plans
lunaires – des arbres faméliques et courbés par le vent,
ce même vent qui soulève la poussière et obscurcit
les consciences – accentuant l'aspect désertique et la sécheresse
dans laquelle ces individus s'ébrouent. Seuls les séquences
de la clinique (l'effraction dans le cadre de sons autres que ceux
de moteurs) et des ligatures des trompes à la chaîne
portent en eux une certaine vitalité, proche de l'onction,
une sensation de patrie et d'appartenance prenant en défaut
l'impunité de l'oasis autarcique et sclérosé.
L'implantation géographique du village et le desserrement de
l'emprise du pouvoir centralisé (éloignement inexorable)
permettent l'émergence de chefaillons, de querelles intestines
pour un pouvoir illusoire et honorifique mais que l'on refuse de partager.
Par des allusions pléthoriques – une prodigalité que
nous retrouverons dans les deux autres moyens métrages et qui
finit par toucher au sublime – le paradoxe des ces agriculteurs-élus,
piégés entre leurs traditions séculaires de travail
et le conditionnement hérité de la révolution
maoïste (on ne saurait déroger à la sacro-sainte
règle de l'enfant unique),
est mis en avant dans sa tragédie culturelle. Le modernisme
ne saurait en aucun cas éluder et occulter l'obscurantisme
ainsi que la stagnation d'un pays désorienté. Il y avait
une saison pour chaque chose, mais une femme peut tomber enceinte
à tout moment. Ils étaient habitués à
récolter des épis de maïs et pas des voix. Il est
saisissant de voir la manière dont M. Lu fomente son "coup
d'état" en secret pour mieux porter le coup fatal en sortant
de la brume dans laquelle il était tapi. En apparatchik fortuné
et calculateur, il se sert sans vergogne des habitants miséreux
à l'intellect malléable pour parvenir à ses fins.
Et fort de son costume ou de son portable il dirige dans l'ombre sa
ville, ayant placé un maire fantoche sur le devant de la scène
et manipulant avec astuce (son abattement suite au départ de
la femme est-il feint ?) une opinion publique grâce à
ses talents de rhétorique (lorsqu'il mime la manière
dont il haranguerait les masses lors de l'annonce de la candidature
de M. Tan sous des accents de plaisanterie la réalité
en filigrane fait froid dans le dos). D'ailleurs la dernière
décision concernant la ligature des trompes (sacrifice acceptable
puisque un nourrisson masculin pleure dans les bras de la jeune mère)
semble venir de lui et non, comme il le proclame, de M. Tan. Dans
cette société qui se libéralise, les magouilles
vont bon train : trafic sur les procurations, votants épiés…
Chassez le naturel, il revient au galop (par les fenêtres, les
embrasures ou les trous de souris), diligent : "devant les soucis,
les hommes chantent, les femmes pleurent et les vieilles parlent".
Constat surprenant et angoissant qu'une démocratie issante
(l'urne de carton transportée sur une mobylette est une image
qui nous hante depuis certains documentaires sur le Tiers-Monde) et
déjà gangrenée et corrompue par ceux qui en connaissent
les rouages. Et que se passera-t-il si M. Lu n'est pas suffisamment
constructif ? Il partira en ville, sûrement avec une avidité
et un désenchantement exacerbés.
| La
Grande Muette. C'est l'influence vivace et rémanente
de la propagande et de la démagogie du régime communiste
qui va servir de toile de fond au second documentaire, avec notamment
une scène d'anthologie (outre les premières images
d'archives) où un cadre du parti, une gradée exaltée,
prétend que la navette spatiale chinoise (Longue Marche
!) peut mettre en orbite trois satellites simultanément
alors que la |
|
|
fusée américaine Ariane (sic) explose très
souvent entraînant des astronautes dans la mort. Comme
quoi la diabolisation d'un ennemi incertain –
et donc menaçant –
n'est l'apanage d'aucune inclinaison politique et certainement
l'escarre de nos sociétés modernes, surinformées
mais privées de données capitales ou du luxe d'un
recul salvateur. Shao Zenning, jeune chinois à la dérive,
sans perspectives et malmené par des parents qui ne comprennent
ni ses échecs ni son indolence aurait certes pu mener
un raisonnement analogue si on ne l'avait sous-estimé.
Prisonnier d'un avenir bouché (ne nous dit-on pas qu'il
doit affronter tout les matins à 6h30 sa condition de
chômeur) et d'un carcan familial dépassé
– le père
dans un élan de défaitisme et de pragmatisme avoue
sa honte de n'avoir pas de position sociale et capitule devant
une société qui évolue tout le temps sans
que l'on puisse s'y acclimater : à ses enfants de se
prendre en main –,
il doit se résoudre au grand drame de ses géniteurs,
qui pleurent beaucoup mais plus d'expiation que de tristesse,
à rejoindre l'Armée. Cette relique d'un passé
révolu mais qui tente de subsister (ressassant stérilement
ses principes obsolètes), de se justifier et de s'enraciner.
Comme vont nous le montrer les classes –
supplice initiatique par excellence –,
les brimades et les humiliations que doit subir le jeune homme,
nous voici face au dernier instrument d'endoctrinement légal.
Car les mentalités des bureaucrates, relents de totalitarisme,
n'ont en rien évolué, à contrario on recherche
à ressusciter cet ancien monde dans des élans
de dévotion. Des dossiers sur tous les événements
de la vie de chaque citoyens sont toujours constitués
(Shao est pourtant né en 1982) et les enquêtes
de moralité balaient et abhorrent les libertés
individuelles. C'est que nous venons d'entrer dans une environnement
saturé de règles où comme le souligne le
jeune soldat ne perdure aucune liberté, chacun devant
garder pour soi opinions ou emportements de peur qu'ils ne scellent
son destin. Ce monstre glouton et castrateur ne craint d'ailleurs
qu'une chose, un questionnement lancinant, risible s'il n'était
effrayant : l'individu absorbé n'est-il pas gâté,
infecté de germes destructeurs et contagieux, soit un
adepte d'une secte. Par-là, l'Armée reconnaît
involontairement cette institution religieuse comme son égal,
la seule à même de purger les crânes, d'éradiquer
toute volonté ou velléités de révolte.
Caméra à l'épaule nous allons suivre l'évolution
d'une psyché brisée, puis façonnée.
A l'aide de plans frontaux, baroques et intenses, le réalisateur
impose sa virtuosité à retranscrire la brutalité
et l'âpreté de l'espace ainsi que le déracinement
des hommes (forcés de boire leur terre –
leurs larmes ? –-
dans une séquence sidérante afin de se retrouver,
de se ressourcer), leur désabusement. La vérité
nue (au grain sale et sordide) à l'image de cette cour
austère de caserne où le dépouillement
d'un panneau de basket dans le lointain s'oppose nonchalamment
à un uniforme pompeux. Tout commence par l'engeance parentale
qui n'a de cesse de rappeler à Shao sa médiocrité,
de l'enfermer dans l'autisme et le mutisme (seule la fumée
de sa cigarette semblant exprimer un sentiment). Son frère
réussit lui et cela ne peut que lui nuire, l'appauvrir
à ses yeux et à ceux des autres. Il s'est laissé
emporter par la spirale de l'échec, distrait et inattentif,
adepte des atermoiements (la scène où il s'arrête
de travailler pour regarder le défilé est tout
bonnement stupéfiante, les bras ballants, le corps informe,
il n'est que spectateur d'une vie qu'il aurait pu avoir et qui
passe, somptueuse et chorégraphiée) il n'a jamais
été brillant et a préféré
suivre de mauvaises fréquentations dans les bars et boîtes
de nuit. Son incapacité chronique à remédier
à son état et ses appétences oisives n'induisent
en aucun cas une quelconque crédulité, le jeune
homme reste au contraire outrageusement lucide quant à
ses possibilités et ses choix d'existence (scène
poignante en état d'ébriété dans
une discothèque). Quelques mois de classes auront suffi
à changer radicalement ses mentalités. Ses mains
crevassées et exsangues (-20°C de température
diurne) sont autant de preuves d'une maturation express, d'un
condensé de vie. Il serait devenu solidaire, travailleur
et discipliné, le vrai stakhanoviste et le soldat –
l'animal –
idéal ? Rien n'est moins sûr puisque les saignements
de nez et les habitudes alimentaires spartiates n'ont en réalité
eu comme résultat que de l'aigrir. A la réponse
négative des premiers jours quant à son engagement
s'il avait connu la rudesse de l'entraînement a succédé
une colère indignée et amère. La dernière
phrase qu'il nous jette au visage, face à la caméra,
donne le vertige : "Vous m'avez sous-estimé. Je
vous déteste". Les évolutions socio-économiques
qui lui ont fait miroiter des icônes de papier (les posters
de sa chambre à consonance japonaise) et d'argile viennent
de le prendre en traître dans la splendeur de leurs mesquineries.
Il est difficile de se plier à de nouvelles conventions
pouvant être contraignantes alors qu'elles prônent
la liberté. La condition d'homme semble se résumer
à la sublime assertion de Laura Kasischke (Un Oiseau Blanc
Dans Le Blizzard), soit ne pas confondre "pour faire
quoi" et "pour quoi faire". Lorsque l'on ne peut
aspirer à un destin différent pourquoi rechercher
une vaine transcendance, forcément avortée. Shao
est à présent mitrailleur, condamné pour
une solde dérisoire à ramper pour deux années
au moins en soulevant la poussière. Il disparaît
de la surface, du paysage et retourne à la terre, son
sépulcre, au néant identitaire et au formatage
cognitif –
le petit livre rouge de Mao dicte encore ses dogmes insensés,
avec une lâcheté insondable puisque l'Armée
recrute et pioche dans les rangs des défavorisés
et des campagnes, les oubliés en plein désarroi
d'un miracle économique inégalement réparti
–, dans le
giron commode, rassurant et bienveillant de la Chine communiste
conquérante, enraciné au plus profond de l'âme
d'un pays séculaire.
| Trains
de vie. Le dernier documentaire est certainement celui
qui touchera le plus le spectateur de par sa structure plus
convenue et ses choix esthétiques plus consensuels
et charmeurs que pour ses prédécesseurs, sans
oublier sa dimension hautement métaphorique. Car
il s'agit bien pour Jiang Yue de se placer au confluent
d'un peuple, à un carrefour aussi bien ontologique
que symbolique pour une population en proie à une
explosion économique aussi fulgurante qu'incontrôlable.
En l'espace de quelques années c'est un système
entier qui tend à imploser, malade de son inanité.
Mais ce que nous montre intelligemment ce réquisitoire
c'est que le bloc communiste ne se désagrège
pas devant la montée irrésistible du capitalisme,
non, bien au contraire les excès de l'un chassent
ceux de l'autre dans un imbroglio inextricable et ne conduisent
qu'au néant, à l'émergence |
|
|
d'une communauté désemparée et dépassée
devant le train chaotique des réformes et du monde.
A travers les yeux de deux hommes, M. Lu et M. Fu, le
portrait d'une classe moyenne tétanisée
se reflète sur l'écran. Des êtres
touchés de plein fouet par les fluctuations économiques,
privés de repères mais plus encore de directives.
Ils sont ces pilotis, bambous lisses et statufiés
émergeant, hiératiques et impassibles, de
la marée humaine. Ils n'y prennent pas part et
se contentent de dodeliner avec les flux. Ils sont comme
l'administration un monolithe perdu dans la brume, l'extérieur
et le progrès s'insinuant en eux par capillarité.
Alors que l'individu avait l'habitude de se fondre dans
la masse, le collectif s'épanche dorénavant
en lui. Pourtant cette distance, ce luxe qui leur échoit
en comparaison des protagonistes précédents,
n'aboutit qu'à les plonger dans la plus sombre
des déprimes, l'errance immobile d'une quête
identitaire. On touche là, avec une limpide évidence,
grâce à la prolixité des regards –
le moyen métrage pouvant même être
ressenti comme l'envers des mentalités chinoises
se reflétant dans des dédales de corridors
vides de corps et de sens mais emplit des échos
de la foule ; ici les blessures sont internes et plus
portées en bandoulière, nous sommes passé
de l'autre côté du miroir en pleine disonance
–, à
la sensation de ne maîtriser aucunement son destin,
les héros n'étant plus que de simples pantins
démunis devant les choix qui s'offrent à
eux (excepté le jeune fils qui, catégorique,
rejettera le futur pour s'enrôler dans l'Armée,
obscure junte rémanence du passé flamboyant
et préférable, car unique et ne nécessitant
aucun choix ultérieurs). Car leur vie n'a plus
rien de stable, elle n'est régie que par les battements
de cœur du chemin de fer, par les départs
incessants (celui du fils, celui du deuil, celui des soldats,
celui de l'amour ou plus prosaïquement, le déménagement),
par des langues inconnues et des sentiments ambivalents
(la joie et la tristesse du départ de l'enfant).
On se laisse dès lors aveugler par l'astrologie
ou les lumières (bleues ou jaunes) d'une économie
prometteuse mais toujours avec une culpabilité
latente (héritée d'une éducation
orientée) d'aspirer à la possession, de
devoir se gérer. Il faut voir M. Lu s'affairer
dans son nouvel appartement acheté à force
de crédits avec une joie infantile teintée
de gêne. Tantôt ébahi, tantôt
hébété, il peaufine l'agencement
du parquet, installe des lampes de couleur et contemple
un spectacle d'André Rieu sur son nouveau téléviseur
muni d'enceintes dernier cri. Là, alors qu'il est
captivé et subjugué, surgit dans ses yeux
une lueur d'inquiétude, comme si la musique venait
de lui rappeler la valse des corps et des destins, la
fébrilité de ses plans de remboursement.
Il bascule alors petit à petit dans la psychose
("avec l'argent on peut tout acheter", une assertion
nouvelle qu'il éprouve dans ses chairs), harcelé
(la nouvelle scolarisation de l'enfant candide qui ne
voulait pas quitter le premier appartement et qui rechignerait
à déserter le nouveau) et harcelant sa femme
quant à ses prochaines rétributions. C'est
que le monde extérieur fluctue sans cesse, en concurrence
avec un passé révolu et chéri puisque
connu. M. Lu aura d'ailleurs cette phrase pleine de dépit,
qui rappelle celle du père de Shao, "la situation
change plus vite que nous". En effet, les deux cadres
démoralisés se retrouvent enchâssés
entre maturité et naïveté (dépourvus
de guides nous confiera M. Fu, avouant ainsi son statut
d'assisté de l'Etat), entre tristesse et joie ("ne
jamais exercer de pressions psychologiques sur un enfant"
argue M. Fu, et s'il parlait de sa propre patrie infantilisée
?). Ils n'ont pas de spécialité dira M.
Lu, en cela ils ne sont pas adaptés au renouveau,
restant consciencieusement et prudemment sur la voie du
milieu (entre les deux files de voyageurs). Ils aimeraient
profiter des avantages de la nouvelle donne économique
et politique mais sans en subir –
en suivre –
les règles. Pour eux, ils se sont engagés
sur une frêle passerelle, celle de l'enferment volontaire.
Avant un paraphe sur un dazibo vous condamnait, aujourd'hui
votre banquier ou votre évaluation professionnelle
s'en chargeront. D'où le besoin de s'ancrer dans
le quotidien, d'échapper le temps d'une futile
respiration à la cacophonie d'une masse grouillante
et anonyme qui, si elle ne peut passer par les portes,
prend le bastion de force par les fenêtres, comme
cette réalité si présente qui occulte
un passé idolâtré en aliénant
ses otages. Qu'importe si, en route, elle sème
un bébé qu'aucune institution ne peut prendre
en charge et que l'on doit confier, la mort dans l'âme,
à un marchand ambulant, ou un cadavre, jeune femme
à l'avenir serein poignardé par un malade
mental. Les deux pans de l'évolution s'affrontent
(en concurrence) à chaque instant et ne laisse
derrière eux qu'un vague no man's land métaphysique
et affectif. Devant l'impossibilité de prévoir
le changement, il vaut mieux ne plus avancer et attendre
la retraite avec son lot de plaisirs simples comme une
virée à la pêche dans sa nouvelle
jeep, l'idéalisation capitaliste d'un vagabondage
élégiaque sans attaches ou responsabilités
(une sorte de soupape, un dégazage). On le voit,
l'influence d'une société de consommation
hétéroclite est déjà palpable
(les sans-abri se multipliant devant la gare), mais cette
dernière s'installe dans la douleur et on ne peut
s'empêcher de se remémorer les paroles de
M. Fu sur sa première épouse morte lors
d'un avortement saboté : "sur une courte période
on ne voit que les qualités". Une introspection
désarmante quant au contrecoup de l'ouverture à
la mondialisation se concluant immanquablement sur un
palanquin de larmes, dans un épanchement lacrymal
et citadin. Frustration d'êtres qui pensaient avoir
payé leur tribut à la patrie (vie de travail,
perte d'une épouse…) et que l'on vient à
nouveau solliciter en les frappant sans ambages dans leurs
valeurs essentielles. Reste l'émotion d'un couple
qui meurt mais qui ne se remettra pas en question, par
lâcheté ou apathie. Surtout ne pas toucher
à l'assemblage précaire, il leur reste trop
peu de temps pour changer quoique ce soit de toute manière.
Alors pourquoi mettre en péril l'édifice
branlant, aux fondations chancelantes ? Ils sont ces chrysanthèmes
blancs perdus dans un champ au jaune chatoyant et diapré,
deux individus englués dans une masse inconcevable,
les cendres et les souvenirs (une tombe et une vie disparaît)
bientôt recouverts par les plus beaux atours d'un
miracle économique à outrance. La nouvelle
conception s'enracine et ils se retrouvent encerclés,
asphyxiés. Fatigués, ils refusent de refaire
l'apprentissage de nouvelles coutumes ou mentalités,
se contentant de regarder le train émerger de la
gare en restant inéluctablement à quai (vision
voluptueuse, feutrée et languissante d'un train
qui se volatilise et s'évapore tandis que M. Lu
demeure impassible, incapable d'esquisser un geste en
contemplant l'étendue de la traînée
désertique, mortifère et pathétique
du progrès social). Stigmatisant ainsi, avec force
allitération, un réel, en imprimant sur
la pellicule plus que ce que l'on ne saurait voir, en
caressant l'âme par des silences, des non-dits et
des aspirations fanées.
|
|
|