

MONK
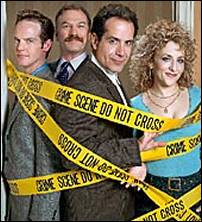
La trame en est assez simple. Elle met en scène Adrian Monk, un ancien flic peu conventionnel de San Francisco à la perspicacité déroutante qui, suite à la mort de sa femme en 1997 et à son incapacité à démêler l’écheveau du drame (sa voiture a explosé dans un parking sans qu’un quelconque mobile se dégage) périclite dans une folie névrotique. Incapable de se confronter à la réalité aussi bien qu’à son environnement, il développe des troubles obsessionnels compulsifs jusqu’ici latents – sur un terrain certes favorable lorsque nous apprenons à connaître ses antécédents familiaux – et malgré le soutien de son ancien collègue le capitaine Leland Stottlemeyer, les services de police finssent par le mettre à pied. Néanmoins, grâce à l’aide de son infirmière personnelle Sharona Fleming, mère célibataire plantureuse, volontaire et extravertie, il réussira à reprendre quelque peu le dessus pour continuer ses investigations et traquer en free-lance pour ses anciens partenaires les scélérats de tous acabits. Pour camper les rôles principaux signalons un Tony Shalhoub (habitué des productions de la fratrie Coen avec Barton Fink et The Barber, écrivain sadique dans le cathodique Stark Raving Mad mais aussi aperçu dans Men In Black, Bienvenue À Gattaca, Primary Colors, ou Sept Jours Et Une Vie) parfait et inspiré, tourmenté et désopilant dans le rôle titre – qui fit pleuvoir sur lui les récompenses dont un Emmy et un Golden Globe dans son escarcelle –, et un Ted Levine qui réussit la gageure d’évoluer aux antipodes de son incarnation de tueur sanguinaire et déviant du Silence Des Agneaux.
Entre-deux. Présentée à tort comme une série policière dont le protagoniste principal serait le légataire universel d’un Columbo aujourd’hui moribond (le criminel et ses exactions nous sont en général présentés dès le pré-générique et n’importe plus alors que les supputations et les péripéties de Monk et consorts pour le confondre), les épisodes oscillent en fait entre énigme alambiquée et comédie délurée – les troubles de Monk étant des sujets inépuisables à railleries attendries. Quelque part entre l’américain, misanthrope et cynique, Pour Le Pire Et Pour Le Meilleur ou le thaïlandais, flottant et lacéré, Last Life In The Universe la fiction embrasse deux composantes souvent disjointes et estompées dans la lucarne pour accoucher d’une immédiateté rassurante, d’un cocon douillet hospitalier à l’équilibre précaire – lorsqu’une des deux familles dramatiques l’emporte sur l’autre l’histoire et son traitement se distendent. C’est qu’elle se conçoit elle-même comme une entité hybride, coincée entre deux genres, deux chaînes, deux siècles – tout à la fois hommage, reconduction des clichés et innovation syncrétique – ou deux catégories (le cachet auteuriste et ciselé du faible nombre d’épisodes façon HBO avec Six Feet Under, La Caravane De L’Etrange ou Les Sopranos infléchit par une réalisation et quelques scripts parfois un peu bradés). A mi-chemin total – un strapontin improbable et branlant –, le héros débloqué et excentrique s’emploie sans cesse à recourir à une logique à double détente (souterraine et apparente) soutenant, pour notre plaisir, une architecture plus que loufoque.
| Cours élémentaire. Deux élans se télescopent en effet dans Monk. Le premier est acéré, rectiligne, fulgurant, comme les cogitations du «héros» qui assène parfois de manière incongrue sa phrase clé, «je sais qui, je sais comment, je sais pourquoi», devant un parterre (personnages et spectateurs) médusé et empêtré dans un mystère opaque autant que fumeux. Le second quant à lui n’est que rondeur : des circonvolutions moelleuses et arrondies |  |
|
dans une sphère ouatée et une troupe amicale qui ne
cesse de s’étendre au fil de l’évolution
du show (la femme du capitaine, la sœur puis la mère
de Sharona, le frère d’Adrian… de nombreux adjuvants
ou camarades et bien peu d’ennemis récurrents à
part Dale «la Baleine» Biederbek). Les deux dynamiques
participent de fait à la transfiguration de la maladie du personnage
principal – dont on appréciera l’obstination des
scénaristes à ne pas se parjurer en faisant disparaître
ses problèmes tétanisants sur un claquement de doigts
dans le feu de l’action (exception faite du vingt-neuvième
épisode où rattrapé par l’affaire du décès
de sa femme il embarque, au débotté, dans une avion
pour New York) – puisque la première consiste peu ou
prou en une transe suspensive (l’enquête débridée
abolissant la culpabilité et enraillant un raisonnement tournant
à vide) et la seconde stigmatisant un véritable retour
en enfance – telle que peut l’envisager et la décrire
le génie ondoyant et gargantuesque d’Hayao Miyazaki.
L’intervention du frère polyglotte de Monk claquemuré
dans la vieille demeure familiale entérine l’analyse
selon laquelle notre «machine à résoudre»
préférée en abhorrant la «beauté
qui déplace les lignes» ne recherche paradoxalement
que l’abolition de la chronologie et l’unité, la
capacité à s’intégrer dans une temporalité
ou un espace desquels il a été définitivement
exclu (enfant il collectionnait disques et posters auxquels il n’entendait
rien simplement pour ressembler aux autres). Le besoin impérieux
de s’occuper l’esprit pour éviter de penser à
la mort de sa femme Trudy et à son cuisant échec est
transcrit avec intelligence, notamment lorsque le mari inconsolable
oublie sciemment des indices pour les reprendre et arriver aux mêmes
impasses l’année suivante, mais culmine surtout avec
l’excellent Mr. Monk Et Le Livreur De Journaux. Dans
cet opus, notre héros se retrouve face à un problème
singulier, son livreur patenté a été agressé
et tué alors qu’il tentait, aux aurores, de déposer
le précieux périodique sur son paillasson. Pour l’enquêteur
chevronné il ne peut subsister qu’une explication : un
criminel ne souhaitait pas que la lecture du quotidien lui permette
de l’appréhender. Et le voici résolvant énigme
sur énigme, de délit de fuite dans sa ville en assassinat
passionnel ayant endeuillé la capitale française. La
vérité, au final, sera tout autre puisque le meurtre
ne le concernait en rien mais la manière dont il rapporte tout
à sa personne, dans un effarement égocentrique, est
un élément indiscutable de sa pathologie. De la régression
infantile naît une compétition puérile où
personnages et scénaristes rivalisent d’ingéniosité
pour brouiller les pistes, inventer les meurtres les plus aberrants,
extravagants ou déconcertants – une propension dont on
vient à se moquer dans Mr. Monk Va Au Mexique, un
noyé en plein ciel il ne fallait quand même pas exagérer,
mais nous l’avons gobé, habitués que nous sommes
au ton sidérant des enquêtes. Dans la vaste cour de récréation
sémaphorique que constitue le programme, on n’a pas fini
de gamberger, de se chamailler pour des peccadilles (question de force,
de vélocité, d’intelligence…) et de se frotter
les uns aux autres pour se jauger ou remporter quelques billes, dont
les réfractions dansantes d’innocence instantanée
et diaprée (durant les séances de psychothérapies
le patient élude la question du sexe par une chanson candide)
suffise à éclipser, un instant du moins, les misères
accablantes et les chagrins extérieurs qui nourrisse d’amertume
les barrières dépitées d’existences statiques. |
|
F.
Flament |

Série américaine créée par Andy Breckman toujours en production (3 saisons, 2002-2004). Avec Tony Shalhoub (Adrian Monk), Ted Levine (Stottlemeyer) et Bitty Schram (Sharona Fleming). Diffusée aux Etats-Unis sur USA / ABC et en France par TF1.




 |

Multimédias
Thème
musical (saison 2)